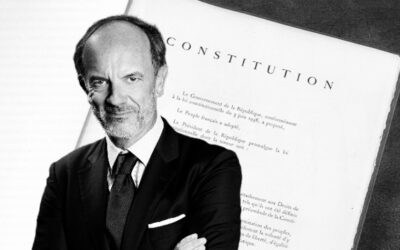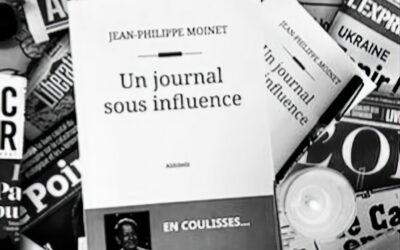Alors que nous fêtons les 65 ans de la Constitution de la Vème République, le Laboratoire de la République interroge Thomas Clay, agrégé de droit et professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Celui-ci a participé en 2005 à la rédaction d'un projet de Constitution d'une VIème République. Il nous explique qu'à ses yeux la VIe République s'est réalisée dans les faits et en partie dans la pratique. Il souligne qu'il importe aujourd'hui de regénérer la Vème par des réformes évoquées dans cet entretien.
Le Laboratoire de la République : Vous avez eu l’occasion de participer à la rédaction d’un projet de Constitution d’une VIe République en 2005. Pouvez-vous revenir sur les raisons qui militaient alors en faveur de cette proposition ?
Thomas Clay : Ce travail s’inscrivait dans la suite du livre d’Arnaud Montebourg, « La machine à trahir » (Denoël éd., 2000) qui avait parfaitement montré les limites et les insuffisances de la Ve République laquelle, en particulier, organise l’irresponsabilité politique de son chef pendant tout le temps de son mandat. Avec notamment Arnaud Montebourg, Bastien François, professeur de science politique, et d’autres, nous nous sommes pris au jeu d’élaborer une nouvelle République, et avons rédigé article par article ce qu’en serait la constitution et nous l’avons publiée (Odile Jacob éd., 2005). On s’est aperçu que le résultat était cohérent et homogène, et prenait le meilleur des constitutions précédentes, tout en essayant de gommer leurs défauts.
L’objectif était aussi de transformer les modalités d’accès au pouvoir, qu’il soit la présidence de la République ou le Parlement, car il était verrouillé par les deux grandes forces politiques du pays depuis la guerre, sans aucune oxygénation. Souvenez-vous que les parlementaires cumulaient les mandats dans le temps et dans l’espace, parfois pendant des décennies, et que les candidats à l’élection présidentielle étaient choisis par d’obscurs aréopages au sein des partis politiques, parfois à trois ou quatre personnes, ce qui avait notamment comme conséquence les succession de candidatures d’une même personne jusqu’à ce qu’elle l’emporte.
Bref, le constat était celui d’une démocratie malade.
Le Laboratoire de la République : Quels éléments vous ont fait revenir sur l’idée même d’une VIe République pour préférer désormais le maintien de la Constitution de la Ve République ?
Thomas Clay : Il y a trois raisons de nature différente qui permettent de penser désormais que, au lieu du grand soir constitutionnel, des modifications du texte actuel pourraient suffire.
D’abord, notre projet reposait notamment sur le fait que le président de la République ne serait plus élu au suffrage universel direct car il aurait moins de pouvoirs, ceux-ci étaient transférés au Premier ministre, responsable devant le Parlement. Or le peuple français reste très attaché à l’élection présidentielle, et il apparaît paradoxal que, au nom d’un renouvellement démocratique, on supprime l’élection à laquelle les Français sont le plus attachés. C’est la quadrature du cercle : soit le président a peu de pouvoirs, et un scrutin au suffrage universel direct n’a pas de raison d’être, soit il a beaucoup de pouvoirs, et alors on le fait élire au suffrage universel direct, et on conserve l’architecture de la Ve République. Comme on disait à l’époque : on ne déplace pas les Français pour élire la Reine d’Angleterre.
Ensuite, depuis cette époque, le mode de sélection des candidats à l’élection présidentielle a été bouleversé, notamment par l’instauration des primaires dans presque tous les partis, avec d’ailleurs des fortunes diverses. L’Assemblée nationale s’est aussi fortement renouvelée. La fin du cumul des mandats a aussi transformé la démocratie locale avec des maires pleinement à leur tâche. D’une certaine manière, l’oxygénation recherchée a déjà eu lieu.
D’ailleurs, et c’est la troisième raison : l’élection d’Emmanuel Macron en 2017 a percuté la Ve République. Non seulement un homme sans parti, avec peu d’expérience, peu de troupes et à moins de 40 ans a été élu président de la République, mais il a en plus éliminé les deux principales forces politiques du pays qui étaient, selon moi, en grande partie responsables de la sclérose du système et qui ne s’en sont toujours pas remise. Or cette élection a eu lieu dans le cadre du système existant, sans le modifier, montrant ainsi sa très grande plasticité. Une constitution qui permet à la fois l’élection du Général de Gaulle et d’Emmanuel Macron montre qu’elle sait s’adapter à tous et à tout, et c’est d’ailleurs pour cela qu’elle a 65 ans. D’une certaine manière, l’élection d’Emmanuel Macron peut être considérer comme l’avènement d’une nouvelle pratique institutionnelle, forgée dans le cadre de la Ve République, mais qui l’a reconfigurée et même dépassée, et qui confine à une nouvelle république. D’ailleurs, l’élection présidentielle suivante fut du même type, et ça ne changera probablement plus. Reste à savoir si cette évolution est durable ou si, en 2027, on reviendra aux pratiques d’avant 2017. La constitution de la Ve République a ainsi trouvé en elle-même les sources de sa régénération, ce qui est très précieux.
Le Laboratoire de la République : Vous avez évoqué lors d’une récente conférence du Laboratoire de la République la nécessité, entre autres, de s’intéresser au statut du Conseil Supérieur de la Magistrature, l’indépendance du parquet ou l’irresponsabilité du Président de la République… Ces évolutions peuvent-elles s’inscrire dans une évolution du corpus juridique de la Ve République ?
Thomas Clay : Autant je pense que la VIe République n’est plus d’actualité, autant il me semble que la Ve République doit faire un nouvel aggiornamento. Notre démocratie est malade, et il suffit de constater l’abstention qui augmente élection après élection pour s’en rendre compte. A quel niveau d’abstention faudra-t-il parvenir pour qu’on change les choses de façon à impliquer davantage les citoyens ? Certes, les expérimentations récentes d’instauration de nouveaux formats démocratiques sont intéressantes et méritaient d’être tentées (Conventions citoyennes, Grand débat, Conseil National de la Refondation, Cahiers de doléances), mais cela ne suffit pas, et on voit se profiler avec angoisse l’arrivée de l’extrême droite dans quatre ans. Si ce funeste scénario se réalise, ce sera aussi le résultat d’une crise de nos institutions et de notre incapacité à les modifier à temps. À ce sujet, l’absence d’alternance au Sénat pendant 62 ans sur 65 ans est une anomalie démocratique qui montre que la Haute chambre est arrivée au bout de sa propre existence. Le mode d’élection des Sénateurs doit être totalement repensé. Pourquoi pas un scrutin à la proportionnelle intégrale, pour disposer une chambre des opinions, à côté de l’Assemblée nationale qui serait la chambre des décisions ?
Les réformes à mener sont connues, j’en soumets quelques exemples à votre réflexion, en vrac, lesquelles ne relèvent pas toutes d’une révision constitutionnelle : réduction sensible du nombre de parlementaires, à 400 pour les députés, à 200 pour les sénateurs, pour que chacun d’entre-eux soit renforcé et plus puissant ; rendre le président de la République responsable pénalement pour les actes commis sans rapport avec ses fonctions car le privilège dont il bénéfice encore est un héritage de la monarchie qui n’a pas sa place dans une république adulte ; suppression de la Cour de justice de la République dont les dossiers récents ont montré qu’elle n’était pas adaptée, si elle ne l’a jamais été ; modification de la composition du Conseil constitutionnel qui n’est plus conforme à ses nouvelles attributions élargies, nées de la question prioritaires de constitutionnalité et en écarter les anciens présidents de la République qui n’ont rien à y faire ; transformation du ministère de la justice en ministère du droit et de la justice avec deux missions bien distinctes, celle du droit et celle de l’action ; suppression des conseils départementaux, et gagner ainsi un étage du mille-feuille administratif ; transformation du Conseil supérieur de la magistrature pour rendre la justice enfin pleinement indépendante ; modification de la justice prud’homale, aujourd’hui à l’agonie ; introduction du droit de vote des étrangers aux élections locales, etc.
On voit que les sujets sont nombreux et importants et qu’il est temps de s’y atteler plutôt que de se fourvoyer dans un bricolage constitutionnel, tel que celui qui se profile pour étendre l’autonomie de la Corse. Ce n’est pas à la hauteur des enjeux du 65e anniversaire de la Ve République.