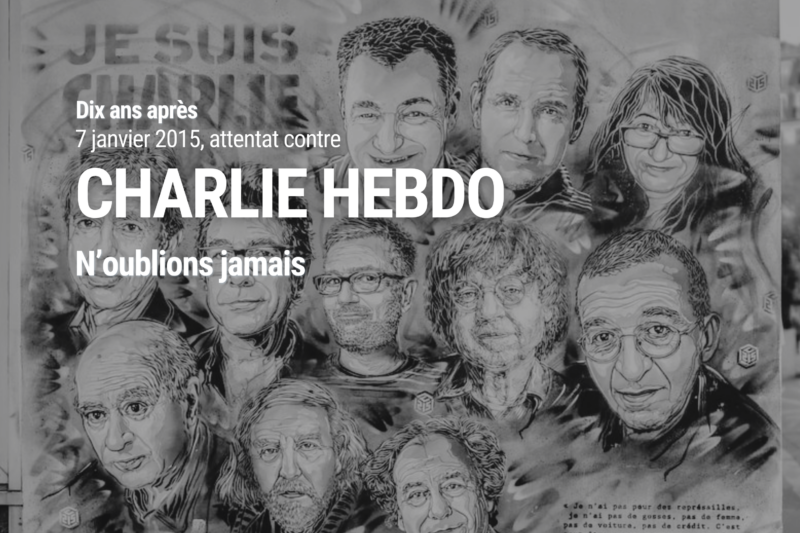Mercredi 21 mai 2025, l'antenne de Lille et la commission République laïque du Laboratoire de la République se sont réunis au Conseil régional des Hauts-de-France. En présence de Xavier Bertrand (président du Conseil régional des Hauts-de-France) et de Jean-Michel Blanquer (président du Laboratoire de la République), des experts et praticiens du monde économique ont apporté leur éclairage sur cette question essentielle qu'est la neutralité en entreprise.
Éric Clairefond, délégué général du Laboratoire de la République, a ouvert la conférence en présentant les objectifs de l’association et en invitant les participants à la prochaine Université d’été du Laboratoire de la République prévue les 28, 29 et 30 août 2025 à Autun.
Jean-Michel Blanquer a lancé la conférence en affirmant la nécessité de défendre les principes républicains, en particulier la laïcité, contre les dérives idéologiques des extrêmes. Il a insisté sur l’importance de clarifier la notion de neutralité dans des espaces particuliers comme le sport et l’entreprise, aujourd’hui insuffisamment encadrés sur le plan juridique.
Xavier Bertrand a rappelé que la loi de 1905 s’applique à tous les agents publics et que la loi du 24 août 2021 contre le séparatisme a élargi cette exigence aux entreprises délégataires de service public. Il a plaidé pour que cette neutralité s’applique aussi aux collaborateurs occasionnels du service public comme les accompagnants de sorties scolaires. Xavier Bertrand a enfin souligné la vulnérabilité des chefs d’entreprise face à la radicalisation, analogue à celle des proviseurs avant la loi de 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques.
Olivier Bavière (DREETS adjoint Hauts-de-France) a présenté l’arsenal juridique existant en matière de neutralité. Il a rappelé qu’un règlement intérieur peut être instauré dans toutes les entreprises, même de moins de 50 salariés, et que celui-ci doit être soumis à l’inspecteur du travail qui peut statuer sur la clause de neutralité. Le salarié ne peut pas invoquer de conviction religieuse pour refuser une application du droit : il lui est interdit de refuser la médecine du travail ou un ordre d’un supérieur au motif que celui-ci soit du sexe opposé.
Peggy Brione (Caisse d’Épargne Hauts-de-France) a évoqué les difficultés d’application dans le secteur privé, où l’enjeu majeur demeure le vivre-ensemble, au-delà de la neutralité. Bien que le règlement intérieur interdise les signes politiques ou religieux ostentatoires, la solidité juridique d’une telle disposition lui parait parfois incertaine s’il devait faire face à une contestation en justice.
Éric Charpentier (Crédit Mutuel Nord Europe) a souligné que, son entreprise disposant d’un règlement intérieur, le prosélytisme est interdit et les employés ne peuvent porter de signes ostentatoires en situation de contact avec la clientèle et le prosélytisme. Un principe de lancement d’alerte anonyme (whistleblowing) auprès de la DRH a été mis en place pour ouvrir le sujet le cas échéant. Le sujet n’est pas tant la neutralité mais plutôt l’accompagnement de la diversité pour vivre ensemble.
Rodolphe Delaunay (Toyota Motor Manufacturing France) a mis en avant une culture d’entreprise forte et inclusive dans son entreprise, appuyée sur le développement personnel et l’implication des salariés. La méthode de Toyota implique des responsables RH de proximité pour coller aux réalités vécues par les salariés. Aucun signe ostentatoire n’est autorisé, mais l’accent est mis sur la cohésion du collectif : les salariés sont par exemple impliqués dans le changement des tenues de travail afin de développer leur sentiment d’appartenance à l’entreprise.
Frédéric Boiron (CHU de Lille) a insisté sur la responsabilité des services publics à être garants des principes de la République. Si les patients peuvent porter des signes religieux, les personnels, eux, doivent se conformer à la neutralité. L’hôpital emploie des aumôniers des trois grandes religions, tout en maintenant des lieux de culte œcuméniques. Les établissements privés, eux, ne sont pas soumis à la même obligation.
Claire Louf (Dalkia) a insisté sur l’importance des normes d’hygiène, de sécurité et de santé qui peuvent également être des outils pour faire respecter la neutralité. Le port de signes religieux ostentatoires est interdit dans le règlement intérieur pour les personnels au contact des clients.
Marc Telliez, proviseur d’un lycée professionnel à Hénin-Beaumont, a illustré comment la laïcité est appliquée dans un établissement mêlant éducation et monde professionnel. Une charte de la laïcité régule les comportements et, malgré une population considérée comme majoritairement défavorisée à Hénin-Beaumont, les cas difficiles sont rares. Il a également souligné que les règles de neutralité s’étendent aux stages et sorties scolaires.
Sophie Béjean, rectrice de la région académique Hauts-de-France et rectrice de l’académie de Lille, a rappelé que le cadre réglementaire est clair, accompagné de guides et de formations pour les équipes éducatives.
Marie-Claude Afarian, formatrice et coach professionnelle, a souligné l’importance du besoin de formation pour les managers, notamment dans les PME, autour des enjeux de communication interne, des aspects juridiques et de gestion émotionnelle face au prosélytisme politique et religieux.
Enfin, plusieurs intervenants ont souligné que la mixité sociale constitue un facteur clé de régulation de la neutralité au quotidien. La neutralité ne se décrète pas uniquement par la loi, mais se construit aussi par la culture d’entreprise, l’exemplarité et l’accompagnement des équipes.
Frédéric Danel, directeur régional de France Travail Hauts-de-France, confirme le besoin d’un cadre dans les entreprises à partir du règlement intérieur. Des formations sur ces enjeux sont mises à disposition dans la formation de rentrée à France Travail. Démystifier le sujet est essentiel pour mieux épauler les équipes.
Michel Lalande, préfet honoraire, conclut la table ronde en rappelant que des mots comme « émancipation » et « vivre-ensemble » l’ont guidé tout au long de son parcours. Pour lui, l’émancipation suppose l’adhésion active aux valeurs de la République, qu’il faut sans cesse interroger, nourrir et faire vivre. Il a insisté sur la nécessité de dépasser les déterminismes sociaux. Le vivre-ensemble, quant à lui, repose sur le respect des règles communes. Face aux atteintes à la neutralité, il appelle à rompre le silence et à devenir des pratiquants de la République.
Le Laboratoire de la République tient à remercier Philippe Lamblin, dirigeant sportif et d’entreprise, délégué aux emplois en Hauts-de-France, pour sa contribution déterminante à la préparation et à l’animation de cette table ronde.
https://www.youtube.com/watch?v=YI9UPI_Wtx0