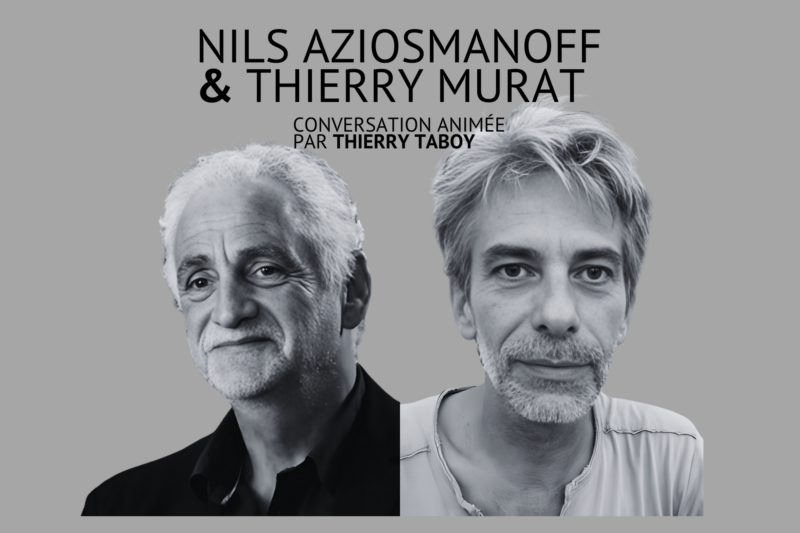L’intelligence artificielle générative bouleverse l’économie, réinvente les processus, mais questionne la
qualité du travail et la souveraineté technologique. Derrière toutes ces promesses, les premières données
appellent à la prudence. L’Europe, elle, doit choisir sa voie — en résistant à la tentation d’un pilotage intégral
par les données.
Créer, pas seulement prédire : un tournant
Là où les intelligences artificielles supervisées se focalisaient sur des analyses ou prédictions ciblées, tandis que le "machine/deep learning" utilise des réseaux de neurones profonds pour traiter automatiquement des données complexes, l'intelligence artificielle générative produit désormais des contenus — textes, images, vidéos, code... Cette capacité offre des potentiels significatifs, mais suscite tout autant d’inquiétudes quant à ses effets en particulier sur l’emploi et les conditions de travail. Or, comme le rappelle l’auteur et essayiste Hubert Guillaud, produire ne signifie pas penser. L’IA calcule, mais ne comprend pas. Elle mime l’intelligence humaine sans jamais l’égaler dans sa capacité réflexive, éthique et critique. Un propos qui complète celui de Bernard Stiegler : « Tout objet technique est pharmacologique : il est à la fois poison et remède s’il n’est pas réfléchi politiquement. ». L’exemple du travail est ici largement représentatif.
Productivité : l’enthousiasme confronté à la complexité du terrain
Les estimations affluent. Le BCG anticipe des gains diffus de 10 à 20 %, et jusqu’à 50 % sur certaines fonctions. Le Hub Institute parle de 2 à 6 % pour les entreprises du CAC 40. Mais ces projections idéalisées rencontrent des limites issues des usages concrets. Début 2024, l’économiste Daron Acemoglu du MIT avait pourtant déjà alerté : les gains de productivité seraient largement surestimés. Un constat partagé par Oliver Wyman, qui souligne que plus d’un tiers des salariés ne perçoivent aucun effet positif après adoption de l’IA, certains observant même une baisse nette de productivité. En somme, ce n’est pas la technologie qui détermine l’impact de l’IA, mais la façon dont on l’intègre dans nos réalités.
Performances contrastées, valeur en tension
Les premières études de terrain confirment cet effet contrasté. Une IA générative bien utilisée peut doper la productivité (+14 % de résolutions horaires en service client, -9 % de temps de traitement, +14 % de conversations simultanées selon les estimations). L’outil devient un amplificateur des compétences. Mais à l’inverse, une étude du BCG menée fin 2023 révèle qu’une mauvaise utilisation provoque une chute de performance. Le débat ne peut ainsi se limiter à la quantité d’emplois détruits ou créés. La qualité du travail est un enjeu tout aussi déterminant. Amazon Mechanical Turk ou les tâches fragmentées “au clic” dessinent un futur du travail pour le moins peu enthousiasmant voire très inquiétant. Il est temps d’élargir les indicateurs : intégrer le bien-être, l’autonomie...
L’outil sans stratégie : le risque du décalage
Ces illustrations posent un problème structurel : le décalage entre les formations dispensées et les besoins opérationnels. Même si l’on peut noter de véritables avancées en particulier dans les grandes entreprises, les projets d’intégration sont encore trop souvent lancés sans analyse d’impact rigoureuse, sans accompagnement d’envergure, ni stratégie de transformation claire. Au final, une adoption chaotique, une démobilisation silencieuse, et des promesses de gains qui tardent à se matérialiser. Avec comme effet une perte de réflexivité dans les organisations. À force d’automatiser sans requestionner les finalités, on risque un management sans pensée, piloté par des indicateurs déconnectés du réel. Des collaborateurs prenant pour argent comptant des réponses erronées de GPT-4 ont à ce titre vu leur efficacité s’effondrer.
Ici se joue l’un des risques majeurs souvent évoqué : celui du désapprentissage par délégation hors supervision humaine. Comme le notent de nombreux chercheurs comme Etienne Klein, à trop vouloir automatiser, c’est notre capacité à débattre en conscience, à préserver notre pensée critique qui en patira.
L’IA ne remplace pas l’expertise : elle en dépend
L’IA générative transforme les gestes, pas les jugements. Elle fait évoluer les métiers sans en supprimer le sens — à condition de les repenser. Le designer peut ainsi devenir curateur, le chirurgien, assisté par un exosquelette intelligent, gagner en précision sans perdre la main. Mais l’expérience humaine reste le socle de la performance. Dans un monde saturé de données, on oublie souvent ce qui échappe à la mesure. La confiance, la relation, l'expérience et l’éthique : autant d’éléments invisibles dans les tableaux de bord mais essentiels à la performance durable. Dans sa course au rattrapage, l'Europe se différenciera par l’intelligence de son déploiement. C’est bien là que se joue l’avenir du projet européen.
Une souveraineté numérique à définir, pas à importer
L’Europe ne contrôle pas la chaîne de valeur de l’IA générative : ni les modèles, ni les serveurs, ni les jeux de données, ni les outils. Une dépendance technologique qui s’accompagne de biais culturels. Entraînés sur des données nord-américaines et bientôt (déjà ?) chinoises, les modèles importent des logiques culturelles et managériales étrangères à nos traditions. L’indépendance à court terme, malgré les efforts déployés sur le vieux continent, reste encore chimérique. Mais une souveraineté fonctionnelle est possible. Elle passe par la diffusion maîtrisée, la spécialisation sectorielle, et l’alignement sur nos forces : industrie, santé, culture, services... Les modèles miniaturisés verticaux sont ici une piste plus que réaliste. Cette autre voie, celle d’un numérique situé, maîtrisé, orienté vers l’utilité collective, est le cœur du défi à venir.
Transformer oui, déraciner non
L’IA générative peut servir la productivité, enrichir le travail, favoriser la créativité et réinventer la notion même de performance. Mais elle exige méthode, gouvernance, dialogue social et investissement humain. Sans cela, elle ne pourra qu'accroître les inégalités, accélérer les désillusions et déstabiliser nos structures sociales. L’Europe n’a pas vocation à copier. Elle a sa propre trajectoire d’innovation à tracer, fondée sur la responsabilité, la réflexivité et plus que jamais le sens.