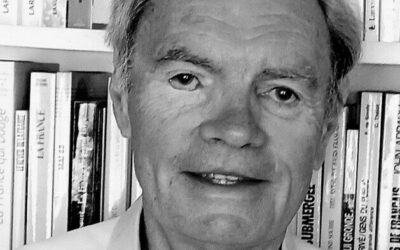Dans cette tribune, Louis-Charles Viossat, responsable de la commission République Sociale, montre comment le temps partiel peut être une solution précieuse pour lutter contre la détérioration du marché du travail. Une solution pourtant largement sous-utilisée en France. En permettant d'intégrer les personnes les plus éloignées du marché du travail, il se pose comme un outil efficace pour tendre vers le plein emploi. Louis-Charles Viossat met cependant en garde contre une utilisation abusive de l'outil qui pourrait conduire à une précarisation excessive et à un temps partiel contraint pour les travailleurs les plus fragiles. Sa démocratisation en France doit être l'occasion de mettre en place un nouveau pacte social.
Réhabiliter le temps partiel en France
A l’heure où la situation du marché du travail se détériore sérieusement, le temps partiel est un ingrédient du plein emploi qui est encore largement sous-estimé en France. Les exemples du Danemark, de l’Allemagne ou des Pays-Bas le montrent pourtant : le temps partiel joue un rôle très efficace d’intégration des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi sur le marché du travail et permet une bonne conciliation entre sphère professionnelle et sphère familiale. C’est également un outil très apprécié de flexibilité pour les entreprises, petites et grandes, comme de gestion des seniors quand c’est nécessaire.
Il y a urgence à réhabiliter le temps partiel dans notre pays, tout en luttant contre les formes de précarité excessive et le temps partiel contraint.
Le temps partiel, angle mort de la politique de l’emploi
En France, la part des salariés à temps partiel, quoique multipliée par 2,5 en cinquante ans, demeure toujours trop modeste au plan européen. Avec 17,4 % de l’emploi salarié en 2023, soit un peu plus d’un salarié sur six, la part des salariés à temps temps partiel, en forte baisse depuis 2017, est inférieure de quatre points à celle des pays de la zone euro et surtout très inférieure à celle des pays du nord de l’Europe comme le Danemark (26,5 %), l’Allemagne (30,2 %) et les Pays-Bas (43,7 %). Au total, l’emploi à temps partiel concerne 4,2 millions de salariés (hors apprentis) dans notre pays. Il est très majoritairement concentré sur certaines catégories de salariés : les femmes, les employés et ouvriers, les immigrés, les entreprises de petite taille et une quinzaine de métiers seulement.
La France se différencie des autres pays également depuis l’instauration, une quinzaine d’années après les 35 heures, d’un plancher minimal de 24 heures hebdomadaires pour les travailleurs à temps partiel. Fixé à défaut par la loi, les accords de branche peuvent certes y déroger. Cette mesure très rigide, censée protéger les salariés de la précarité et éviter la floraison des petits boulots à l’allemande ou à la britannique, a pourtant été une arme à double tranchant : elle n'a pas permis d’accroître la quotité de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel, qui n’a pas bougé depuis dix ans, et elle a eu, semble-t-il, un impact négatif sur le volume de l’emploi féminin. En outre, l’instauration du plancher est intervenue à une période où commençaient à progresser deux autres échappatoires : les contrats de moins de sept jours et les missions de travailleurs indépendants, en particulier d’auto-entrepreneurs. On a assisté ainsi, singularité française, à un envol des CDD de moins d’une semaine entre 2011 et 2017 puis après le Covid.
Certains travailleurs à temps partiel, et particulièrement parmi le million de ceux qui sont à temps partiel dit contraint, c’est-à-dire qui n’ont pas trouvé d’emploi à temps plein alors qu’ils en cherchent, souffrent d’une situation parfois problématique de leurs conditions de travail, et notamment d’une fragmentation pénalisante de leur temps de travail. Les agents d'entretien ou les aides à domicile cumulent ainsi, parmi d’autres professionnels, les difficultés : horaires décalés, coupures multiples dans la journée, temps de trajet non rémunérés entre deux interventions, amplitudes journalières extensibles et faibles rémunérations…
Or ni le système de formation ni le service public de l’emploi ne leur prêtent une attention particulière et le système socio-fiscal engendre lui-même des trappes à temps très partiel : les salariés avec une faible quotité horaire ne gagnent parfois, voire souvent, pas plus en travaillant plus ; et cela coûte très cher à leurs employeurs pour autant d’accroître cette quotité !
Pistes et propositions pour un nouveau pacte social
La France a besoin d'un pacte social en faveur du temps partiel adapté au XXIème siècle. Un pacte qui reconnaisse d’abord le bien-fondé de son développement dans l’économie et la diversité des situations et des aspirations. Un pacte qui donne les moyens aux salariés qui souhaitent travailler à temps partiel de le faire, notamment les femmes et les hommes avec charges d’enfants, les personnes ayant des problèmes de santé ou ceux qui veulent accroître leur quotité de travail. Un pacte qui offre aussi des garanties de conditions de travail et de rémunération dignes, en particulier pour les salariés à temps partiel contraint.
Le temps partiel doit devenir dans notre pays, comme il l’est dans d’autres, un choix positif et un véritable outil d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Un droit au temps partiel pour une durée déterminée, comme il existe déjà dans la fonction publique, mais également dans les entreprises allemandes ou néerlandaises, serait notamment, à ce titre.
Le temps partiel est un superbe sujet de négociation pour un nouvel accord interprofessionnel et du grain à moudre dans les branches les plus concernées par ce type de salariat (services à la personne, propreté, HCR…).
S’agissant du million de salariés à temps partiel contraint, il y a matière à assouplir le cadre légal actuel tout en renforçant les garanties pour les salariés les plus exposés. La CFDT demande l’instauration, comme il en existe dans la branche de l’animation, d’une indemnité d’emploi à temps partiel équivalente à 10% de la rémunération des travailleurs à temps partiel, avec une possibilité de dérogation par accord de branche, ce qui permettrait de négocier des conditions de travail plus favorables. A contrario, le MEDEF demande, pour sa part, la suppression pure et simple de la règle de la durée minimale de 24 heures ou, à défaut, une simplification du formalisme du contrat de travail à temps partiel.
A mi-chemin de ces positions, on pourrait assouplir le régime des heures complémentaires et des compléments d'heures, en les assortissant de contreparties plus favorables pour les salariés : bonification minimale de 10% pour les compléments d'heures, majoration salariale dès la deuxième coupure journalière, rémunération des temps de trajet inter-vacations…
De leur côté, les donneurs d'ordre, publics et privés, ont une part de responsabilité importante vis-à-vis de beaucoup de travailleurs à temps partiel contraint et fragmenté. Trop souvent, ils se défaussent sur leurs sous-traitants, notamment dans le secteur de la propreté, perpétuant ainsi un modèle économique basé sur la précarité. Ils doivent prendre leurs responsabilités sociales plus au sérieux.
De même, le service public de l’emploi et le système de formation professionnelle doivent mobiliser davantage les dispositifs existants en faveur des salariés à temps partiel, et en particulier ceux qui veulent travailler plus. S’il y peu à attendre, en pratique, de la formule des groupements d’employeurs qui demeurera une solution intéressante mais marginale, l’utilisation intensive de l’intelligence artificielle pour un meilleur appariement des offres et des demandes sur le marché du travail offre des perspectives importantes quoique complexe à mettre en oeuvre.
Au fond, c’est en améliorant la qualité de l’emploi, en assouplissant la réglementation là où il le faut et en la durcissant ailleurs, qu’on parviendra à accroître aussi la quantité d’emploi dans notre économie. Qualité et quantité vont de pair.
Il y a urgence à agir sur ce front-là aussi, et à agir de façon décisive, au vu des perspectives préoccupantes de la croissance et de l’emploi.