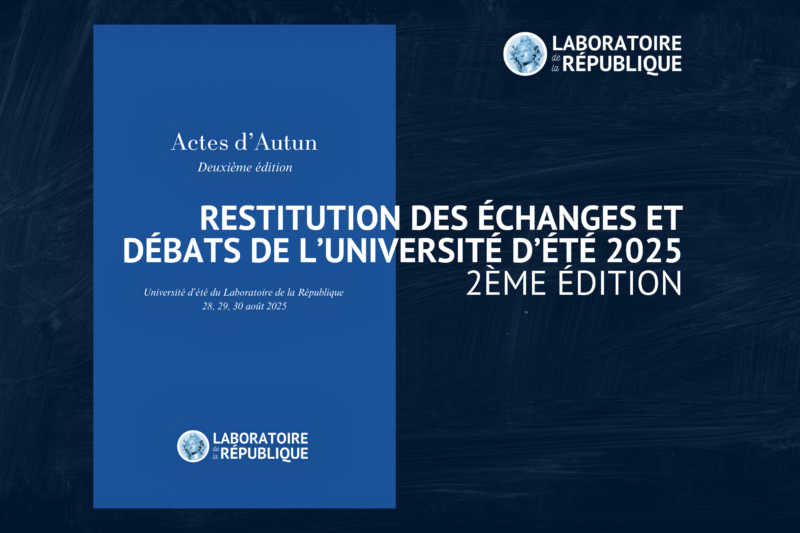Dans un monde lancé à vive allure mais privé de boussole, nos sociétés semblent avancer vers toujours plus de richesses apparentes au prix d’inégalités accrues, d’un épuisement écologique et d’une fragilisation démocratique profonde. Face aux crises qui s’additionnent - sociales, climatiques, géopolitiques, culturelles, Louis-Charles Viossat, responsable de la commission République sociale, appelle à changer de cap. Cette tribune esquisse les fondations d’une prospérité durable, réconciliant justice sociale, souveraineté économique, innovation, culture et exigence républicaine, pour redonner à la France un horizon commun et une stabilité à la hauteur des défis du siècle.
Chaque jour qui passe, une réalité s’impose en ce début d’année 2026 très particulier et si chaotique. Nos sociétés avancent vite, mais sans gouvernail, dans une fuite en avant : toujours plus de production, plus de richesses et plus de consommation, mais aussi toujours plus d’inégalités économiques et sociales, de tensions internes et désormais de désordre international majeur. Nous croyons toujours bâtir la prospérité mais nous creusons la dette écologique et sociale de notre monde et nous nous éloignons de plus en plus de la stabilité et de la paix.
Cette course effrénée, qui se conjugue avec des mouvements migratoires croissants, une dépopulation qui s’accélère au Nord, des crises — financières, sanitaires, géopolitiques — toujours plus graves et fréquentes et des populismes désormais débridés nourris par des réseaux sociaux incontrôlés, met désormais en péril la santé démocratique de nos sociétés. Si nous continuons à vivre comme si nos ressources étaient infinies, nos institutions pérennes et nos nations indissolubles, nous allons droit vers la rupture et vers l’éclosion de conflits domestiques et internationaux majeurs.
Il est temps de changer de cap. De dessiner un nouveau modèle qui réponde à des principes respectueux et garants des équilibres écologiques, économiques et sociaux. Un modèle qui réajuste le rapport de forces entre l’économique et le social, qui respecte les limites de la planète, et qui sache puiser dans la créativité des femmes et des hommes autant que dans la puissance des technologies pour recréer du lien social et une croissance soutenable.
Intégrer les contraintes écologiques et les limites de la planète
Il y a urgence à trouver les moyens d’une prospérité qui respecte les limites de la Terre et les besoins de l’homme : remplacer les énergies fossiles par des filières locales d’énergies renouvelables, conditionner les aides publiques aux entreprises à la réduction de leur empreinte carbone ou instaurer une fiscalité écologique dont les recettes financent directement la transition et la lutte contre la précarité énergétique sont des pistes sérieuses. Cela impose aussi d’investir massivement dans les projets de recherche et de développement des énergies nouvelles, de transformer profondément notre appareil de formation pour l’orienter vers les nouveaux métiers, en lien avec le changement climatique et la transition numérique et de l’intelligence artificielle générative, et de mobiliser les diplomaties européennes en direction des pays du Sud global pour prolonger les engagements de la COP en dépit du défaut américain.
Les dérèglements climatiques et l’effondrement des écosystèmes ne sont pas des abstractions : ils frappent d’abord les plus vulnérables. C’est la vallée inondée qui chasse ses habitants, l’agricultrice surendettée après des années de sécheresse et d’inondations, le chauffeur-livreur et l’ouvrier du bâtiment qui suffoquent dans une ville surchauffée. Ils exacerbent les mouvements de populations, les conflits et obèrent la croissance. Chaque grande décision publique ou privée devrait être évaluée à l’aune des limites planétaires, de la préservation des ressources et de l’héritage que nous laisserons.
Rééquilibrer le rapport de forces entre le social et l’économique
Cette ambition n’oppose pas la liberté d’entreprendre à la solidarité, ni la compétitivité au progrès social. Elle revient à dépasser les clivages anciens entre État et marché pour bâtir un contrat national autour d’un objectif simple : que le travail et l’effort soient justement récompensés, que nul ne soit laissé de côté et que la mobilité sociale l’emporte sur la rente et l’héritage.
Les décisions économiques ne peuvent plus être prises désormais comme si elles étaient détachées de leurs conséquences humaines. La santé d’une nation ne se mesure pas seulement au PIB, mais au bien-être de ses habitants, à la vitalité de ses territoires, à la cohésion de son peuple. La justice sociale peut redevenir notre boussole : nul ne doit être laissé dans l’angle mort de la République — ni l’ouvrier au salaire stagnant, ni l’aide-soignante épuisée, ni l’étudiant qui cumule études et petits boulots, ni l’agriculteur qui travaille sans relâche tous les jours de l’année. Cela suppose de garantir à chacun un socle effectif de droits fondamentaux : un logement digne à un prix accessible, un accès égal à une santé de qualité, à l’éducation et à la formation tout au long de la vie, ainsi qu’une protection sociale qui sécurise vraiment les parcours, en particulier pour les jeunes et les travailleurs précaires.
Pour cela, nous avons besoin de partenaires sociaux forts, vraiment représentatifs, responsables et respectés par les pouvoirs publics, capables de négocier la modernisation du pays et des progrès pour tous les travailleurs, en sachant concéder sur certains points pour mieux se battre sur d’autres.
Nous devrons également rechercher une fiscalité plus juste, qui encourage l’égalité des chances et empêche la concentration excessive des patrimoines comme aujourd’hui. L’impôt doit redevenir l’expression de la solidarité nationale, et la transmission du patrimoine doit servir la justice sociale. Sans justice fiscale, pas de cohésion sociale durable ; sans égalité des droits, pas de République digne de ce nom ; sans finances publiques assainies, pas de croissance équilibrée. Cela signifie qu’il n’y a pas d’alternative à des efforts importants et rapides d’économies sur les retraites et l’assurance maladie.
Chaque euro investi par l’Etat doit être justifié par son efficacité sociale, écologique ou économique. Il ne faut promettre que ce que l’on peut financer, et financer effectivement ce qui a été promis. La solidarité nationale doit aussi aller de pair avec la responsabilité individuelle. Les droits sociaux ne sont pas des rentes, mais le fruit d’un effort collectif auquel chacun doit contribuer selon ses moyens.
Une prospérité durable suppose aussi de libérer les énergies créatives. Cela veut dire simplifier les démarches pour les entrepreneurs, encourager l’investissement productif, et soutenir nos PME et ETI innovantes qui exportent le savoir-faire français. L’État devrait moins étouffer par la norme et plus accompagner par la stratégie, en misant sur des filières d’avenir où nous pouvons exceller : hydrogène, biotechnologies, agriculture durable, économie circulaire. C’est en faisant confiance aux initiatives privées, tout en fixant un cap clair et en ayant une stratégie de finances publiques sérieuse et crédible que nous conjuguerons compétitivité et justice. Nous ne pourrons financer ni la solidarité ni la transition écologique sans une économie forte.
S’appuyer sur l’innovation sociale autant que sur les nouvelles technologies
L’intelligence artificielle, la robotique, les télécommunications ou l’industrie spatiale progressent à grand pas. C’est en aidant à la recherche, au développement et au bon usage de ces nouvelles technologies que nous trouverons des solutions et pas en freinant ou en faisant l’autruche. Mais le progrès ne réside pas seulement dans l’invention d’outils toujours plus puissants, il réside aussi dans la capacité à créer des solutions collectives qui changent la vie des gens.
L’innovation sociale, c’est aussi l’entreprise qui associe ses salariés aux décisions, la collectivité qui relocalise l’alimentation scolaire, l’association qui forme les jeunes aux métiers de demain. Ces initiatives de la société civile peuvent devenir la norme plutôt que l’exception. Pour cela, l’essaimage des dispositifs de participation citoyenne à l’élaboration des choix publics permettant à tous, y compris aux plus modestes, de prendre part aux choix qui orientent l’avenir de leur territoire est un point clé : budgets participatifs, jurys citoyens, implication accrue des partenaires sociaux et des associations dans l’élaboration des politiques publiques.
Faire de la souveraineté économique notre armure
La souveraineté économique n’est pas un slogan, c’est une condition d’indépendance. Elle se traduit par la capacité à décider de notre destin productif, à préserver nos savoir-faire, à lutter contre les délocalisations qui vident nos villes et nos campagnes de leur substance. Produire mieux plutôt que produire plus ; privilégier la qualité, la durabilité, la relocalisation : c’est la filière bois qui renaît dans le Jura, l’atelier textile qui reprend vie à Roanne, le chantier naval qui embauche à Saint-Nazaire. A cette fin, la création d’un grand fonds souverain où investir une partie des ressources de l’assurance retraite, dessiller les yeux des autres pays de l’Union européenne sur l’utilité de tarifs douaniers plus adaptés à l’échelle européenne et privilégier les circuits courts de production et de consommation sont souhaitables.
La souveraineté économique passe aussi par un bouclier de services publics dans tous les territoires : accès à la santé, à l’éducation, aux transports, afin d’éviter que des zones entières ne se sentent abandonnées par la République.
La souveraineté économique exige également une politique migratoire lucide et maîtrisée. Accueillir doit rester un choix, non une fatalité subie. Nous pouvons mieux contrôler nos frontières communautaires, fixer des quotas adaptés à nos besoins sectoriels de main-d’œuvre, et conditionner le droit au séjour au respect des lois et des valeurs de la République. Mais la politique migratoire, c’est aussi une politique d’intégration courageuse et solidaire. Celle-ci se construit par l’apprentissage du français, l’accès au travail, la lutte acharnée contre les discriminations et une participation active à la vie civique. Il n’y a pas de paix sociale durable ni de développement économique si des pans entiers de la population vivent à l’écart de la communauté nationale.
Préserver la culture comme notre ancre dans un monde en voie d’uniformisation
La culture n’est pas un luxe : c’est ce qui nous relie à ce que nous avons de plus précieux, la mémoire des arts, la force de l’éducation, la liberté du débat. Elle vit dans la voix du libraire qui défend ses auteurs, dans la classe d’une institutrice qui initie ses élèves à la poésie, dans le geste de l’artisan qui perpétue un savoir-faire. Un pays qui perd sa voix devient une province anonyme du village global. Défendre la culture, c’est défendre notre capacité à penser librement, à dialoguer avec notre passé, à inventer notre avenir. Cela exige de faire de l’école et de l’université un grand chantier d’avenir, de promouvoir la création artistique sous toutes ses formes, de garantir un accès équitable aux arts et aux savoirs en soutenant financièrement les librairies indépendantes, en renforçant l’éducation artistique à l’école, en protégeant le financement public du cinéma et du théâtre… Préserver notre culture, c’est aussi affirmer ce qui nous unit : notre langue, notre histoire, nos paysages, notre art de vivre. Ces trésors ne sont pas tournés vers le passé, ils sont les fondations sur lesquelles nous bâtissons l’avenir.
Un nouveau cap pour le pays ne passe donc ni par la colère facile de la démagogie, ni par les grands soirs dangereux de la révolution. Il suppose de réinventer une troisième voie : exigeante dans ses objectifs, réformiste dans ses méthodes, démocratique dans son esprit. De sortir du productivisme pour entrer dans l’âge où l’on juge la réussite d’une nation à la qualité de vie de ses habitants et au degré de cohésion nationale. Et de mettre en cohérence les valeurs collectives qui sont proclamées avec la réalité de nos actions d’une part, et avec les vertus individuelles des dirigeants comme des citoyens.
Pour porter cette ambition, l’État devra se reconstruire et se réformer : moins centralisateur, plus agile, concentré sur ses missions régaliennes et stratégiques, et laissant plus de place aux initiatives locales et à la décentralisation, pourquoi pas dans le domaine de la santé et de l’éducation comme dans beaucoup d’autres pays. Il est grand temps de simplifier aussi le mille-feuille administratif.
Sans sécurité, il n’y a ni liberté, ni prospérité, ni confiance. C’est pourquoi l’ordre public doit être garanti avec fermeté, en donnant aux forces de l’ordre les moyens matériels, juridiques et humains d’agir, tout en exigeant un respect strict des droits fondamentaux. La cohésion nationale ne se maintient pas seulement par des politiques sociales ou économiques efficaces : elle se défend aussi par une présence républicaine forte et de services publics dans chaque quartier, chaque village, chaque territoire et par la prévention de toutes les incivilités.
Nous n’avons pas vocation à choisir entre justice et compétitivité, entre culture et économie, entre environnement et progrès. Nous avons vocation à les unir, dans un équilibre qui permette à chacun de s’accomplir, à la société de se tenir, à l’économie de prospérer sans détruire ce qui la rend possible. C’est cette ambition véritablement fraternelle qu’il nous faut réapprendre à inventer et à servir. Alors seulement nous pourrons dire que nous sommes fidèles à l’esprit de la République.
Louis-Charles Viossat est responsable de la commission République sociale du Laboratoire de la République.