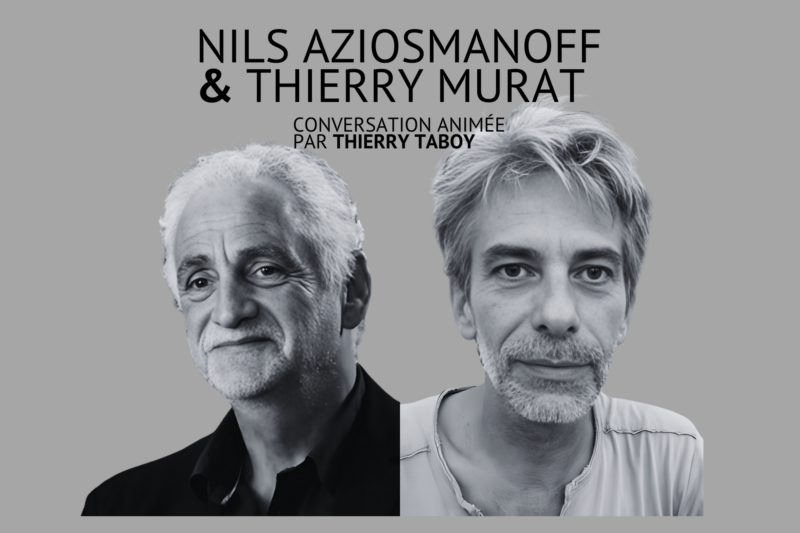La diffusion de l’intelligence artificielle, en particulier de l’IA générative, constitue sans doute l’un des bouleversements structurels les plus profonds de ce début de XXIe siècle. Si les jeunes générations en sont les principaux utilisateurs au quotidien, elles pourraient aussi en devenir les premières victimes sur le marché du travail. Plusieurs signaux faibles, notamment aux États-Unis, laissent déjà entrevoir cette possibilité. Il est temps d’agir pour éviter qu’elle ne devienne réalité.
Des opportunités nombreuses, mais des signaux d’alerte
Les économistes et les organisations internationales, telles que l’OCDE ou l’OIT, ont jusqu’ici abordé l’impact de l’IA sur l’emploi avec un certain optimisme, tant en termes de volume que de qualité. Le rapport Aghion-Bouverot, remis en 2024, conclut ainsi à « un effet positif de l’IA sur l’emploi dans les entreprises qui l’adoptent ». Selon ses auteurs, l’IA remplace des tâches, non des emplois, et seuls 5 % des postes seraient directement substituables dans un pays comme la France. Ils estiment par ailleurs que l’IA créera de nombreux postes, dans des métiers nouveaux comme dans des secteurs existants. Des ajustements seront nécessaires dans certains domaines, mais l’effet global sur l’emploi national ne serait pas négatif.
L’Organisation internationale du travail, souvent critique à l’égard des transformations de l’emploi, a elle aussi publié des analyses globalement positives, y compris dans les pays du Sud.
Sur le papier, les jeunes, premiers utilisateurs de l’IA, pourraient être les grands bénéficiaires de cette transition. L’IA améliore la productivité des salariés les moins expérimentés, crée de nouveaux usages et, donc, de nouveaux postes naturellement accessibles aux jeunes actifs. Selon une étude récente, 70 % des jeunes Américains de 18 à 25 ans considèrent l’IA générative comme une opportunité pour développer leurs compétences.
Mais cet optimisme est aujourd’hui largement tempéré par l’évolution du marché de l’emploi des jeunes aux États-Unis. La Réserve fédérale de New York a récemment publié un rapport faisant état d’une dégradation notable de la situation des diplômés du supérieur au premier trimestre 2025 : le taux de chômage des jeunes diplômés y approche les 6 %, son plus haut niveau depuis 2021. Même les sortants des meilleurs MBA peinent à trouver un emploi.
Trois explications émergent dans les analyses américaines. La première est conjoncturelle : les marchés de l’emploi dans la tech, le conseil ou la finance n’ont jamais retrouvé leur dynamique d’avant-Covid, ni même celle d’avant la crise financière de 2008. La deuxième est structurelle : depuis 2010, les diplômes universitaires procurent un avantage moindre sur le marché du travail, comme l’a souligné la Réserve fédérale de San Francisco.
La troisième hypothèse, plus préoccupante, met en cause l’effet même de l’IA. Selon un responsable de LinkedIn, les outils de codage assisté remplacent peu à peu les tâches simples qui servaient de tremplin aux jeunes développeurs. Hors secteur tech, les fonctions traditionnellement confiées aux jeunes recrues – rédaction de synthèses, recherches juridiques, saisie et traitement de données – sont elles aussi largement automatisées.
Les premiers secteurs touchés seraient la finance et l’informatique, où les gains de productivité liés à l’IA sont les plus marqués. Dario Amodei, PDG d’Anthropic, estime que la moitié des emplois de début de carrière des cols blancs pourraient disparaître d’ici cinq ans, avec un risque de chômage atteignant 10 à 20 %, notamment dans les fonctions routinières ou standardisées – celles précisément occupées par les jeunes actifs.
Même sans scénario aussi abrupt, les grandes entreprises technologiques – naguère avides de jeunes talents – privilégient désormais les profils expérimentés. Selon Business Insider, les recrutements de jeunes diplômés dans les grands groupes comme Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ou Tesla auraient chuté de plus de 50 % depuis 2022. Dans les start-up de la Silicon Valley, la baisse atteindrait 30 % depuis 2019.
Certaines directions des ressources humaines inciteraient même leurs équipes à envisager l’option IA avant d’ouvrir un poste. En retour, les jeunes diplômés, anticipant ces mutations, se détournent des carrières autrefois prisées, notamment dans la finance ou la tech. En France, les données précises font défaut, mais l’inquiétude semble elle aussi croître dans les universités et parmi les jeunes diplômés.
Agir pour ne pas subir
Face à ces bouleversements, l’inaction serait une erreur stratégique. Des réponses existent, mais elles supposent une mobilisation rapide et ambitieuse.
Mieux connaître. Il est urgent de mieux suivre l’évolution du marché du travail des jeunes en France. À ce jour, les outils d’analyse ne permettent pas une observation fine, régulière et en temps réel. La mobilisation coordonnée de la statistique publique, en lien avec des acteurs privés comme LinkedIn, les cabinets de recrutement et les DRH, est indispensable.
Former massivement. L’enseignement de l’intelligence artificielle doit être significativement renforcé, dès le secondaire et à l’université. Le rapport Villani de 2018 appelait déjà à tripler le nombre de personnes formées en IA, en féminisant les filières, en créant des cursus croisés (droit-IA, par exemple), et en soutenant des parcours de formation du niveau bac+2 au doctorat. Six ans après, le rapport Aghion-Bouverot réaffirme la nécessité de former, sans délai et à tous niveaux, tant les concepteurs de solutions d’IA que leurs utilisateurs ou les citoyens appelés à vivre dans une société augmentée par l’IA.
Cela implique également de renforcer les formations STEM (sciences, technologies, ingénierie, mathématiques), notamment pour les jeunes les plus vulnérables, afin d’éviter une nouvelle fracture numérique. Parallèlement, les soft skills – communication, collaboration, créativité, résolution de problèmes – doivent être revalorisées dans les parcours éducatifs. Ces compétences, difficilement automatisables, constituent un levier essentiel d’insertion pour les jeunes.
Un pacte pour les jeunes
Les employeurs ont, eux aussi, un rôle crucial à jouer. Les jeunes n’attendent pas un monde sans IA, mais un monde dans lequel ils ont leur place. Les entreprises doivent éviter une automatisation brutale, préserver les débuts de carrière et parier sur le potentiel humain. Dans ce cadre, les partenaires sociaux pourraient engager une négociation interprofessionnelle pour bâtir un pacte en faveur de l’emploi des jeunes. Celui-ci pourrait conjuguer des engagements sur l’orientation, la formation, l’accès au marché du travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et les conditions de travail.
La relation entre l’IA et l’emploi des jeunes ne sera pas univoque. Elle produira des gagnants et des perdants, selon les choix politiques, économiques, éducatifs qui seront faits. La révolution est en marche ; son issue, elle, reste à écrire. L’enjeu dépasse la seule sphère technologique. Il est profondément social.