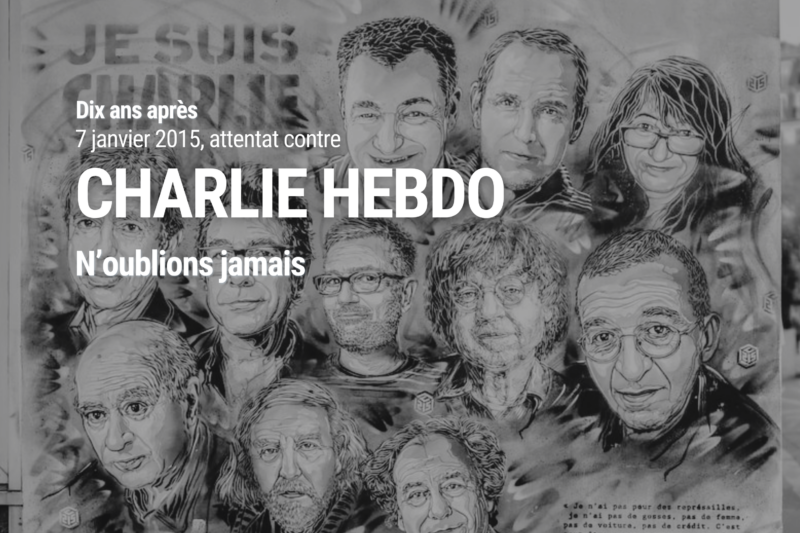Comment conjuguer liberté religieuse et vivre-ensemble dans notre République ?
C’est à cette question brûlante qu’ont répondu, le 24 septembre 2025 à Bordeaux, le grand imam Tareq Oubrou, le professeur de droit public Ferdinand Mélin-Soucramanien, la présidente de la LICRA Bordeaux-Gironde Sarah Bromberg et le prêtre Basile Dumont. Entre cadre juridique, éducation des jeunes, égalité femmes-hommes et diversité des pratiques spirituelles, la soirée a offert un débat riche et sans détour sur la laïcité, ce pilier républicain qui nous unit tous.
Le 24 septembre 2025, le Laboratoire de la République inaugurait son antenne bordelaise à l’occasion d’une conférence consacrée au thème « Laïcité et religions : quels chemins pour vivre ensemble ? », en présence de Ferdinand Mélin-Soucramanien (professeur de droit public), Tareq Oubrou (grand imam de Bordeaux), Sarah Bromberg (présidente de la LICRA Bordeaux-Gironde) et de Basile Dumont (prêtre de la paroisse de Talence).
Les échanges ont permis d’explorer ce principe fondateur de la République sous ses dimensions historique, juridique, sociologique et contemporaine, confirmant que la laïcité est une condition essentielle du vivre-ensemble, tout en révélant les tensions qui traversent son application dans un contexte marqué par la pluralité religieuse et l’évolution des pratiques sociales.
Un cadre historique et juridique en constante évolution
La laïcité s’enracine dans des jalons législatifs majeurs, comme le souligne Ferdinand Mélin-Soucramanien : la laïcisation de l’enseignement en 1882, la séparation des Églises et de l’État en 1905, ou encore la récente loi de juillet 2025 contre le racisme et l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur. Trois piliers en structurent la définition : liberté de conscience, séparation de l’État et des cultes, et obligation de se conformer aux règles communes sans invoquer ses croyances.
Le Conseil constitutionnel a lui-même cherché à la définir, notamment dans une décision de 2004, au moment où se posait la question de l’articulation entre la Constitution française et le projet de Traité pour une Constitution européenne. Il avait alors affirmé que la laïcité interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes. Cette interprétation, à laquelle Ferdinand Mélin-Soucramanien dit se rallier, fait de la laïcité non seulement une garantie de liberté mais aussi une condition du vivre-ensemble et un pilier de la République.
Religion, société et jeunesse : des rapports contrastés
Loin d’être un principe figé, la laïcité s’adapte aux évolutions sociétales. Tareq Oubrou rappelle que toute religion ne se vit pas seulement, elle se pense également. Faute d’un travail d’interprétation et de médiation doctrinale, une « sainte ignorance » traverse toutes les religions. L’accès direct et sans filtre aux contenus religieux via les réseaux sociaux favorise ce qu’il appelle une « désécularisation sauvage », où les jeunes, souvent plus connectés à TikTok qu’à leurs propres parents ou à des médiateurs, se montrent parfois plus religieux que la génération précédente.
Dès lors, l’enjeu de la transmission devient central. « On ne peut pas obliger quelqu’un à adorer Dieu », rappelle Tareq Oubrou, soulignant que la coercition religieuse, physique ou psychologique, est non seulement juridiquement interdite mais théologiquement vaine. La foi suppose liberté et intention. D’où l’importance, selon lui, d’introduire le doute, la pédagogie et une éducation au discernement dès l’enfance.
Dans cette perspective, Sarah Bromberg insiste sur la dimension éducative et citoyenne de la laïcité, notamment auprès des jeunes, mais aussi sur l’égalité entre femmes et hommes, qui doit demeurer un principe intangible dans la société.
Liberté religieuse, espace public et ordre républicain
La laïcité se situe à l’intersection de la liberté religieuse garantie par le droit, y compris européen, et de la neutralité attendue des institutions. Les discussions ont rappelé une distinction fondamentale : si les agents du service public doivent rester neutres, l’espace public ne saurait être totalement aseptisé.
Ferdinand Mélin-Soucramanien a insisté sur la nécessité de renforcer la neutralité dans certains services particulièrement sensibles, comme l’hôpital public et les transports. Mais il met en garde contre une crispation excessive sur les signes religieux dans l’espace public.
Cette distinction a été largement reprise par les intervenants : la République est laïque, mais l'ensemble des individus constituant notre société ne l’est pas. La laïcité n’est pas une religion ni une idéologie, mais une branche commune « sur laquelle tout le monde est assis », selon l’expression de Tareq Oubrou, et que chacun, croyant ou non, a le devoir de défendre car elle protège tous les citoyens.
Une recomposition du paysage religieux
Les évolutions religieuses en France reflètent à la fois un reflux global et des dynamiques de renouveau. Basile Dumont souligne par exemple l’augmentation significative du nombre d’adultes demandant le baptême, multiplié par deux en quelques années, signe d’un regain de quête spirituelle. En parallèle, les travaux de politistes comme Yann Raison du Cléziou mettent en évidence un mouvement plus général de reflux des pratiques religieuses.
Tareq Oubrou cite aussi Peter Berger, sociologue américain, qui dès les années 1980 constatait le retour du religieux dans l’espace politique, notamment à travers les mouvements évangéliques. La France n’échappe pas à cette recomposition, où coexistent désaffiliation et réinvestissement religieux.
Perspectives et recommandations
Les intervenants ont formulé plusieurs recommandations pour l’avenir :
• Clarifier davantage encore la distinction entre liberté dans l’espace public et règles strictes de neutralité dans les services publics, à renforcer dans certains services particulièrement sensibles.
• Promouvoir une sensibilisation large aux valeurs républicaines et encourager un dialogue respectueux entre convictions.
• Encourager un portage politique large de la laïcité, afin qu’elle demeure un projet républicain d’espérance partagé et défendu par le plus grand nombre.
• Développer une éducation au discernement et à la liberté de conscience, en protégeant les jeunes contre toute forme de coercition.
https://www.youtube.com/watch?v=SxaB1GuYIg4